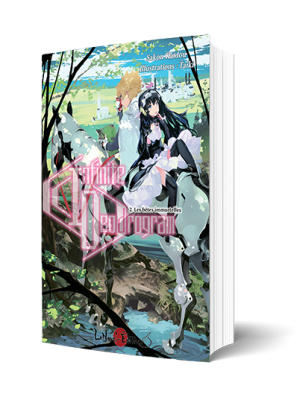LES ARSENAUX DE MARINE EN FRANCE
ISBN : 9782353570348
⧫ Editeur : GLENAT
Extrait
Extrait de l'introduction : Le 6 juillet 2001, M. Lionel Jospin, alors Premier ministre, signa la décision de transformer ta Direction des constructions navales en entreprise de droit privé dont l'État détiendrait le capital. Une révolution de velo...
Extrait de l'introduction : Le 6 juillet 2001, M. Lionel Jospin, alors Premier ministre, signa la décision de transformer ta Direction des constructions navales en entreprise de droit privé dont l'État détiendrait le capital. Une révolution de velo...
En réaprovisionnement
Autre
Autre
Date de parution : 13/11/2008
Extrait
Extrait de l'introduction :
Le 6 juillet 2001, M. Lionel Jospin, alors Premier ministre, signa la décision de transformer ta Direction des constructions navales en entreprise de droit privé dont l'État détiendrait le capital. Une révolution de velours renversait un système industriel et une culture coulés dans le bronze depuis la fondation de l'arsenal de Narbonne et du Clos des galées de Rouen par Philippe le Bel.
Le débat sur le statut des arsenaux était, de longue date, périodiquement relancé sur le principe de la construction navale militaire, son organisation, ses avantages et ses inconvénients en termes d'indépendance nationale, de spécificité, de soutien de la filière navale française, de gestion et de coûts d'acquisition et d'entretien. Dans les années 1906-1907, la controverse agitant les politiques depuis vingt ans sur le rendement des arsenaux à l'ère industrielle et sur le recours aux entreprises privées devint très vive. Les études montraient que la tonne de cuirassé coûtait 22 % de plus en France qu'en Allemagne et 30 % de plus qu'en Angleterre. La comparaison pouvait atteindre 50 % pour les croiseurs. Il y avait beaucoup d'explications à cela, la plupart n'étant pas à la charge des arsenaux. Les dépassements des coûts étaient favorisés par le monopole de la Chambre syndicale de la construction navale sur les devis des fournitures métallurgiques et la répartition concertée des adjudications de constructions neuves. Ils étaient entraînés par les innombrables modifications apportées aux plans initiaux. La série des six cuirassés Danton de 1906 en connut cinq cents, dont rien moins que te remplacement des machines alternatives par des turbines et le changement de l'artillerie principale. Le corollaire était la lenteur de nos constructions, souvent rendue de toute façon inéluctable par l'émiettement des crédits de paiement. L'Angleterre construisait après la Première Guerre mondiale un cuirassé en deux ans, la France en quatre ou cinq. La tradition a perduré puisque, quelques décennies plus tard, décidé en 1980, le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle est entré en chantier en 1987 et a été admis au service actif en 2001. Cette lente gestation ne nuisit pas à ses exceptionnelles qualités opérationnelles mais elle eut bien sûr des inconvénients.
Le rapport du projet de budget de 1908 critiquait les effectifs et les plans de charges des arsenaux de Rochefort, de Cherbourg et de Toulon. Il dénonçait l'étalement abusif des programmes de sous-marins dans le seul but d'occuper les ouvriers sans souci d'efficacité ni d'économie. À l'issue de débats houleux sur la mise en condition de la marine, il fut admis que les arsenaux pouvaient ne pas fonctionner toujours à plein rendement puisqu'ils avaient une fonction tampon, mais que tous les efforts devaient être faits pour les optimiser en hommes et moderniser leurs machines. Les moyens n'étaient pas pléthoriques en réalité, et le prolongement inconsidéré d'unités vieillissantes contribuait à surcharger les arsenaux. Rochefort et Lorient absorbaient les pointes des programmes navals dépassant les capacités de Brest et de Toulon.
Le 6 juillet 2001, M. Lionel Jospin, alors Premier ministre, signa la décision de transformer ta Direction des constructions navales en entreprise de droit privé dont l'État détiendrait le capital. Une révolution de velours renversait un système industriel et une culture coulés dans le bronze depuis la fondation de l'arsenal de Narbonne et du Clos des galées de Rouen par Philippe le Bel.
Le débat sur le statut des arsenaux était, de longue date, périodiquement relancé sur le principe de la construction navale militaire, son organisation, ses avantages et ses inconvénients en termes d'indépendance nationale, de spécificité, de soutien de la filière navale française, de gestion et de coûts d'acquisition et d'entretien. Dans les années 1906-1907, la controverse agitant les politiques depuis vingt ans sur le rendement des arsenaux à l'ère industrielle et sur le recours aux entreprises privées devint très vive. Les études montraient que la tonne de cuirassé coûtait 22 % de plus en France qu'en Allemagne et 30 % de plus qu'en Angleterre. La comparaison pouvait atteindre 50 % pour les croiseurs. Il y avait beaucoup d'explications à cela, la plupart n'étant pas à la charge des arsenaux. Les dépassements des coûts étaient favorisés par le monopole de la Chambre syndicale de la construction navale sur les devis des fournitures métallurgiques et la répartition concertée des adjudications de constructions neuves. Ils étaient entraînés par les innombrables modifications apportées aux plans initiaux. La série des six cuirassés Danton de 1906 en connut cinq cents, dont rien moins que te remplacement des machines alternatives par des turbines et le changement de l'artillerie principale. Le corollaire était la lenteur de nos constructions, souvent rendue de toute façon inéluctable par l'émiettement des crédits de paiement. L'Angleterre construisait après la Première Guerre mondiale un cuirassé en deux ans, la France en quatre ou cinq. La tradition a perduré puisque, quelques décennies plus tard, décidé en 1980, le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle est entré en chantier en 1987 et a été admis au service actif en 2001. Cette lente gestation ne nuisit pas à ses exceptionnelles qualités opérationnelles mais elle eut bien sûr des inconvénients.
Le rapport du projet de budget de 1908 critiquait les effectifs et les plans de charges des arsenaux de Rochefort, de Cherbourg et de Toulon. Il dénonçait l'étalement abusif des programmes de sous-marins dans le seul but d'occuper les ouvriers sans souci d'efficacité ni d'économie. À l'issue de débats houleux sur la mise en condition de la marine, il fut admis que les arsenaux pouvaient ne pas fonctionner toujours à plein rendement puisqu'ils avaient une fonction tampon, mais que tous les efforts devaient être faits pour les optimiser en hommes et moderniser leurs machines. Les moyens n'étaient pas pléthoriques en réalité, et le prolongement inconsidéré d'unités vieillissantes contribuait à surcharger les arsenaux. Rochefort et Lorient absorbaient les pointes des programmes navals dépassant les capacités de Brest et de Toulon.